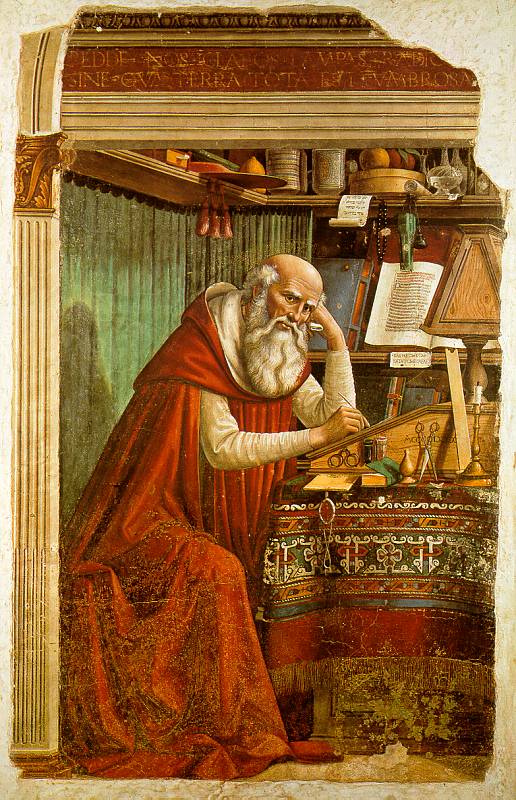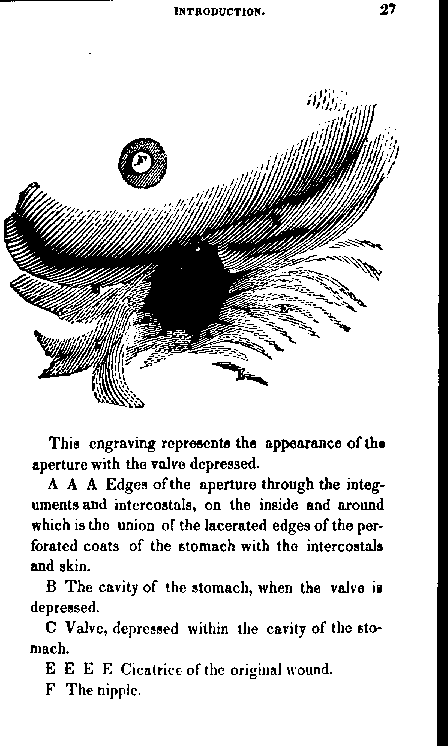De nos jours, la course, c’est pu qu’une affaire! Tu peux pas juste te lâcher su’l trottoir un samedi matin en coton ouaté avec les vieux chouclaques que t’as trouvés en liquidation chez Sports Experts en 2003 pis qui pognent le poil de chat dans l’fond du garde-robe depuis c’te temps-là. Oh non! Ça te prend un ti kit en dry fit qui moule la poche avec des souliers fluo qui arsemblent à des Hot Wheels, achetés au Coin des coureurs avec l’aide de Jean-Simon, un grand slaque sympathique qui fait des ultramarathons de malade dans le désert pis qui étudie en physio. Faut que t’ailles à des « cliniques » de course, que tu te mettes des plasteurs sur les mamelons pis SURTOUT, que t’en parles à TOUT LE MONDE.
Par contre, ça a pas toujours été de même.
Pour vous donner une idée, au marathon olympique de 1904 à St. Louis, aux États-Unis, y’a un facteur cubain qui s’est pointé à la ligne de départ avec un gilet à grand’ manches lousses, des culottes longues qu’y avait coupées aux genoux pour faire comme des shorts, un béret pis des bottines. On était loin du ti kit en dry fit qui moule la poche.
Mais, entre vous pis moé, son linge était probablement l’affaire la moins bizarre de c’te marathon-là : en faite, du début à la fin, ce fut un chiard que tout le monde aurait mieux aimé oublier.
Dans ce temps-là, le marathon, c’tait l’épreuve reine des Jeux. Mais, à St. Louis, toute se passa tellement tout croche qu’on aurait dit que ça avait été organisé par ton mononcle alcoolique dans les trails de quatre-roues en arrière de chez eux pour le Festival du frappe-à-bord avec une commandite du garage Wilbrod Brodeur pis du dépanneur Chez Ginette.
Su la ligne de départ, y’avait queques marathoniens expérimentés, comme les Américains Thomas Hicks pis William Garcia. Mais sinon, la majorité des coureurs qui étaient là auraient jamais fait la sélection olympique d’à c’t’heure. Entre autres, y’avait :
- Fred Lorz, un Américain qui s’entraînait de nuite après la job pis qui s’tait qualifié en gagnant une course « spéciale » de 8 km qui avait rien à voir avec un marathon;
- dix Grecs qui avaient jamais couru un marathon de leu vie;
- Len Taunyane pis Jan Mashiani, deux Sud-Africains noirs qui se pointèrent nu-pieds;
- pis, ben sûr, notre facteur cubain de tantôt, Félix Carvajal – y’avait perdu toute son argent en jouant aux dés à la Nouvelle-Orléans pis y’avait dû se rendre à St. Louis su’l pouce, sans manger.
D’habitude, les longues courses de même, ça commence de bonne heure pour éviter aux coureurs la chaleur pis l’soleil de midi, hein? Ben, pas là. Quand le signal de départ fut donné, y’était trois heures et queques de l’après-midi, y faisait chaud pis humide comme dans le péteux de Lucifer, pis les gars se lâchèrent pour le plus épouvantable 40 km* de leu vie.
Au début, c’tait pas trop pire : les coureurs devaient faire deux fois le tour du stade olympique, su’l plat pis su l’asphatte. Mais après, la course continuait sur un chemin de terre, pis là, ce fut l’enfer. Y’avait plein de côtes à monter pis à descendre. Y’avait de la roche partout, pis les gars manquaient tout le temps de se dévarser les pieds. Les chars officiels avec les docteurs pis les entraîneurs à bord soulevaient d’la poussière qui r’volait dans’face des coureurs pis les faisaient tousser à s’en arracher les poumons.
À part ça, parsonne avait rien faite pour bloquer le chemin : les gars devaient se faufiler au travers des camions pis des wagons de train pis du monde qui promenaient leu chien. Dans ce bordel-là, c’t’un miracle que parsonne se soit faite écraser.
Pis comme si c’tait pas assez de la marde de même, un jambon nommé James Sullivan – nul autre que l’organisateur en chef des Jeux – s’tait mis dans’tête que ça serait pas pire de profiter du marathon pour voir c’que ça faisait quand t’empêchais le monde de boire pendant un gros effort physique. Faique y mit juste deux points d’eau sur toute le parcours : un réservoir à 9 km, un puits sur le bord du chemin à 20 km, pis rien pour les 20 derniers kilomètres. C’tait une vraie décision de cabochon qui aurait pu coûter des vies – pis ça passa proche.
Les coureurs tombaient comme des mouches. À cause du manque d’eau, y’en a plusieurs qui pognèrent des crampes et durent abandonner. Fred Lorz, par exemple, décida d’arrêter pis pogna un lift dans un des chars officiels. D’autres dégueulèrent su’l bord du chemin au point de pu pouvoir continuer, pis une autre gang pogna le flux à cause de l’eau contaminée au puits du kilomètre 20.
Un des coureurs, William Garcia, avala tellement de poussière qu’y se déchira l’estomac pis faillit mourir au boutte de son sang sur le bord du chemin.
À r’garder aller Félix Carvajal, on n’aurait pas cru qu’y courait un marathon olympique. Pas pressé pantoute, y s’arrêtait pour jaser avec le monde grâce au peu d’anglais qu’y connaissait. Étant donné qu’y crevait de faim, y s’arrêta pour cueillir des pommes le long du parcours, ben relax, comme un touriste à l’île d’Orléans. En tout cas, on va y donner ça, à Félix : c’tait un gars qui savait profiter de la vie. Malheureusement pour lui, les pommes étaient pourries; pogné du mal de ventre, y se coucha dans le foin et s’endormit comme une masse.
Pendant ce temps-là, Len Taunyane, un des deux Africains, avait pas mal moins de fun : y se faisait courir après par des chiens enragés, pis y s’artrouva écarté à quasiment deux kilomètres du parcours.
En avant de toute, Thomas Hicks donnait toute ce qu’y avait. Lui, son but dans’vie, c’tait gagner un marathon, pis la victoire était à sa portée. Mais, rendu à 11 km du fil d’arrivée, y’était pu capable. Y faisait pu yinque se traîner les pieds, pis y voulait juste se coucher dans le fossé pis rester là pour toujours.
Y supplia les gars de son équipe pour avoir de l’eau, mais à la place, y lui donnèrent… Du poison à rats. Wô oui! Pour de vrai, là! C’tait de la strychnine, en fait. Dans ce temps-là, on en utilisait souvent à p’tites doses pour donner un coup de fouette aux athlètes – faut croire que les règlements su’l dopage étaient pas mal plus lousses. Entécas, ça eut l’air de ravigoter Hicks, qui s’armit à courir.
Et c’est là que Fred Lorz arvint dans la course.
Ben oui, toé! Après avoir faite un boutte en char, Lorz se rendit compte que sa crampe était passée, faique y débarqua pis s’armit à courir comme si de rien n’était. Y clancha Hicks à toute vitesse pis franchit la ligne d’arrivée devant une foule en délire, toute heureuse d’être contente qu’un Américain ait gagné.
Alice, la fille du président américain Teddy Roosevelt, mit la couronne du vainqueur su sa tête, mais juste comme a l’allait lui passer la médaille d’or autour du cou, quequ’un arriva tout indigné pis dit :
— Arrêtez-moi ça tusuite! C’t’un tricheur! Y’a faite quasiment la moitié de la course en char!
— Ben voyons, c’tu vrai, ça?
La foule se mit à huer.
« Euh… répondit Lorz avec un sourire de ti-gars qui vient de se faire pogner la main dans’boîte de gâteaux Vachon. C’tait une joke? »
Y fut disqualifié drette là.
Complètement découragé de s’être fait dépasser par Lorz, Hicks était sur le bord d’abandonner. Mais, quand on y’expliqua c’qui venait de se passer, y’eut un p’tit regain. On y’ardonna encore une shot de strychnine, du blanc d’œuf pis du brandy.
Y’arpartit donc de plus belle, la face blême, les yeux dans’graisse de bines, les bras raides comme des 2×4 pis les genoux qui pliaient quasiment pu.
Un m’ment’né, y se mit à halluciner :
— J’en peux pu, y me reste encore 30 km! C’est bin que trop loin…
— Ben non, Tom, ar’garde! On le voit, le stade, là, t’es quasiment rendu!
— J’ai faim, astie!
— Tantôt la bouffe, Tom, tantôt. Tu veux-tu encore du brandy, à’ place?
— Envoye donc…
— Quins, ça va-tu mieux, là?
— Veux me coucher… Laissez-moi juste me coucher à terre…
— No-non, Tom, arrête pas, là, tu vas gagner! Enweille!
Y fit le dernier boutte dans le stade, soulevé par ses entraîneurs, les pattes qui se faisaient aller dans le vide, comme si y touchait encore à terre.
Pis malgré les 358 affaires qui l’auraient faite disqualifier aux jours d’à c’t’heure, Tom Hicks fut sacré champion olympique. Y venait de réaliser le rêve de sa vie, mais c’est sûrement pas de même qu’y devait s’imaginer son moment de gloire. Y’était tellement brûlé qu’y fut même pas capable de se tenir deboutte pour arcevoir sa médaille; y fut emmené direct à l’hôpital. Imaginez-vous donc, y’avait perdu huit livres pendant la course!
Su les 32 athlètes qui prirent le départ, y’en a juste 14 qui franchirent la ligne d’arrivée, dont Len Taunyane, qui avait réussi à se débarrasser des maudits chiens qui y couraient après pis finit neuvième.
Pis Félix Carvajal, lui?
Y’eut beau s’épivarder à droite pis à gauche tout le long de la course, y finit quand même quatrième. Pas pire, hein? Y doit avoir une leçon à tirer de t’ça à quequ’part…
* Ouin, 40 km? C’est pas 42,195 km, la distance du marathon?
Avant toute, faut dire que la course appelée « marathon » était pas une épreuve traditionnelle des Jeux olympiques de l’Antiquité. Nenon. Nos ancêtres avaient pas mal plus de bon sens que nous-autres. L’affaire, c’est que quand le Français Pierre de Coubertin décida, yinque s’une gosse, de ressusciter les Jeux, y se rappela une légende grecque : celle de Philippidès, un messager qui aurait couru d’une traite les 40 km entre les villes de Marathon pis d’Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses, avant de s’écrouler raide mort.
« Heille, se dit-il, messemble que ça rendrait un bel hommage à c’te gars-là que de d’mander à une nouvelle génération d’athlètes de courir jusqu’à ce qu’y pètent au frette! »
Faique aux Jeux de 1896 et 1900 pis à nos fameux Jeux de 1904, le marathon s’est couru s’une distance de 40 km. Mais aux Jeux de Londres, en 1908, y’eut un p’tit problème : la famille royale voulait absolument que la course se tarmine drette en avant de sa loge au White City Stadium. Pis d’la manière que l’parcours était faite, y’en manquait un ti peu.
— Shit, qu’est-cé qu’on fait? W’é pas pour toute arfaire le parcours au complet pour que ça arrive flush, ça va être ben que trop d’trouble!
— Ouin. Ch’pense qu’on n’aura pas l’choix de rallonger la course. Gad’, on va mesurer, là… Quins. Jusqu’à loge, ça f’rait 42,195 km.
— Messemble que ça fait bâtard. C’est même pas un chiffre rond!
— Mais ch’cré ben que ça va être ça pareil. À moins que ça te tente d’aller expliquer ça au roi en parsonne?
— Non, ça va être beau! Faisons ça.
Pis la distance du marathon est toujours restée de même par après!